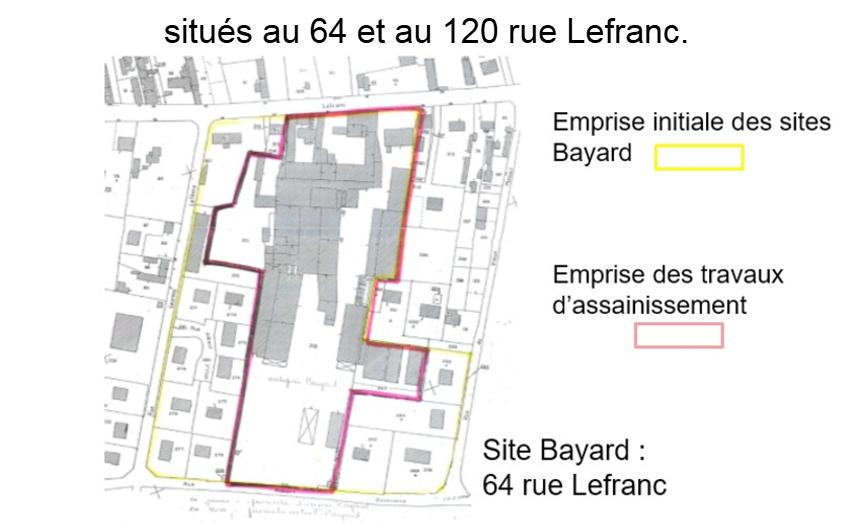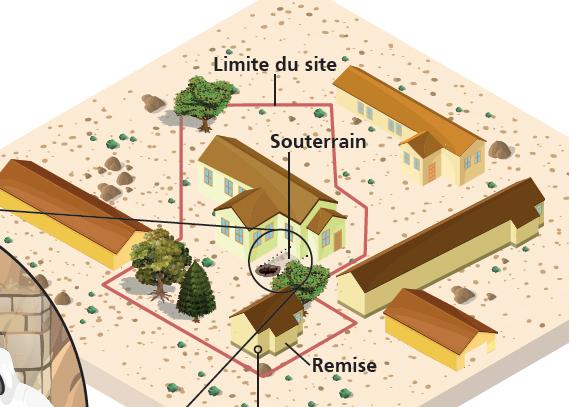Une doctrine qui adapte les moyens aux enjeux
Octobre 2025
L’ objectif poursuivi lors de l’assainissement d’un site pollué dépend de multiples facteurs. Des usages prévus du site, de la faisabilité technique de l’assainissement, des coûts et l’impact des pollutions résiduelles des différents scénarios envisagés.

Sur un site pollué par des substances radioactives, l’objectif doit-il être d’enlever toute radioactivité d’origine humaine, quels que soient les moyens nécessaires, ou d’optimiser ces moyens - qui ne sont pas infinis - pour les concentrer là où ils seront le plus efficace ? Cette question fait l’objet d’arbitrages par les autorités compétentes. L’ Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) contrôle ainsi les installations nucléaires de base ou les activités relevant du code de la santé publique. Pour les sites dits « orphelins », où l’exploitant ou le responsable de la pollution a disparu ou est insolvable, c’est le préfet du département qui est chargé de prescrire les actions à engager pour réhabiliter le site.
Aussi loin que raisonnablement possible

En octobre 2012, l’ Autorité de sûreté nucléaire1 édite sa propre doctrine concernant l’assainissement des installations nucléaires de base, autour de quatre grands principes : traçabilité et transparence, implication des parties prenantes – dont les riverains -, application du principe pollueur-payeur, et du principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable2). Ce dernier consiste à enlever le maximum de radioactivité possible en utilisant des moyens raisonnables, avec comme référence l’assainissement complet lorsque c’est atteignable. Un objectif également poursuivi, par ailleurs, par l’Opération diagnostic radium (ODR), qui répertorie en 2010 tous les laboratoires industriels ou privés connus ayant manipulé du radium en France au 20e siècle. C’est le cas, par exemple, des ateliers ayant utilisé des peintures au radium dans l’ancienne industrie horlogère. Des pavillons ou des structures collectives ont parfois été construits sur ces sites désaffectés. Plus d’une centaine de sites sont identifiés. Et la mission est clairement fixée : enlever sur ces sites tout becquerel d’origine industrielle. Mais l’ampleur du chantier consomme rapidement les ressources disponibles. Dès 2014, le budget provisionné est épuisé, alors que seuls 30 sites prioritaires ont pu être diagnostiqués. Onze révèlent des traces de pollution au radium 226 (dont seuls quatre avec des risques d’exposition du public supérieure à la limite de 1 mSv/an) et sont assainis. « Cela a contribué à faire émerger la nécessité de réfléchir à une nouvelle approche. Elle vise à mieux identifier au préalable les enjeux - quels sont les risques ? pour qui et quels usages ? - et à prioriser les sites les plus dangereux. L’idée est de chercher un équilibre entre efficacité technique et coût économique, pour assainir aussi loin que raisonnablement possible », relève Odile Palut-Laurent, référente gestion des sites et sols pollués à l’ASNR.
Des scénarios compatibles avec les usages

Dans sa doctrine mise à jour en 2023 pour les installations nucléaires de base, l’ASNR garde l’assainissement complet3 comme scénario de référence permettant une libération inconditionnelle du site. « Mais en cas de difficultés, l’exploitant peut soumettre des scénarios d’assainissement adaptés, compatibles avec les usages du site », précise Odile Palut-Laurent. Ces usages comprennent ceux actuels, les usages « envisagés » (ceux auxquels le site est destiné), mais aussi « envisageables », pour couvrir l’ensemble des possibles. Comme une utilisation agricole du sol, l’installation d’un centre de loisir, ou d’une résidence voire d’une crèche pour les sites en agglomération. « Y a-t-il un risque qu'une personne soit exposée à la pollution des sols ? Ou en consommant des produits cultivés sur place ? Des particules contaminées peuvent-elles être dispersées dans l'air et inhalées ? Toutes ces hypothèses doivent être étudiées », détaille Rodolphe Gilbin, expert en radioprotection des populations et de l’environnement. Son équipe évalue alors l’impact sanitaire, en retenant différents scénarios d’exposition possibles.
L’analyse du risque radiologique est par ailleurs de plus en plus couplée à celle du risque chimique, car les deux sont imbriqués. L’uranium, par exemple, est à la fois un élément radioactif et un métal toxique pour les organismes. L’impact sur l’environnement lui-même est aussi pris en compte, à partir des connaissances disponibles sur des organismes représentatifs des écosystèmes.
Mettre en place une surveillance
Ces impacts ont-ils été bien évalués ? La méthodologie employée est-elle la bonne ? Sur quels éléments précis se fonde l’analyse coûts-avantages ? Tous ces éléments fournis par l’exploitant du site sont analysés par l’ autorité compétente (ASNR ou préfet). Si les seuils d’exposition réglementaires sont dépassés, celle-ci peut, entre autres, restreindre les usages possibles du lieu et/ou mettre en place une surveillance de l’environnement. Le préfet crée un Secteur d’information sur les sols (SIS4) accessible au public, qui en est ainsi informé.
1. L’ Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est devenue ASNR en janvier 2025, par fusion avec l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire).
2. Aussi bas que raisonnablement atteignable.
3. La nouvelle doctrine fixe un seuil d’exposition maximale de 10 microsieverts/an pour une libération inconditionnelle.
4. Les Secteurs d’informations sur les sols (SIS) sont des zones géographiques françaises où des études de pollution des sols sont nécessaires. Leurs créations et mises à jour sont gérées par le préfet de département. Ils sont téléchargeables par le grand public sur le site web du Ministère de la transition écologique.
Pour en savoir plus
Guide méthodologique - Gestion des sites potentiellement pollués par des substances radioactives : https://www.asn.fr/reglementation/guides-de-l-asnr/guide-methodologique…
Guide de l’ASN n°24 : Gestion des sols pollués par les activités d’une installation nucléaire de base https://www.asn.fr/reglementation/guides-de-l-asnr/guide-de-l-asn-n-24-…
À Serquigny (Eure), une contamination circonscrite mais à maintenir en mémoire
Une contamination radiologique dont la compatibilité avec les usages reste à surveiller et à compléter par une caractérisation chimique des milieux. C’est la conclusion toute en nuances publiée1 en 2024 par les experts pour le site Arkema de Serquigny (Eure). La Société de terres rares y traitait au 20e siècle de la monazite, riche en thorium et en uranium. Une activité qui a engendré des résidus radioactifs, entreposés par le nouveau propriétaire Arkema après assainissement du site.
L’état des lieux réalisé par cette société révèle en 2006 une contamination des sédiments de la rivière voisine, la Risle. Arkema évalue en 2022 son impact sanitaire et environnemental, et présente différentes pistes pour réduire les expositions induites. « Des solutions intéressantes, dès lors que l’industriel s’assure qu’il n’y a pas de contamination nouvelle. Nous avons demandé à l’industriel de vérifier l’absence de radioactivité dans les eaux rejetées par leur usine dans la rivière », précise Marie-Odile Gallerand, experte en gestion de sites radiocontaminés.
Les mesures ne montrent pas d’exposition des riverains supérieure à 1 mSv/an pour des usages pénalisants comme des activités de loisir (promenade, jeux, pêche…). « Nous avons vérifié sur place les usages de la rivière et il s’avère que celle-ci est difficilement accessible au niveau de la zone contaminée », précise l’experte. Les teneurs mesurées sont sans effet connu sur l’écosystème, aucun impact n’ayant été relevé sur les populations d’invertébrés. Un suivi environnemental est néanmoins préconisé, avec conservation de la mémoire et surveillance des usages.
Peut-on réduire cette exposition en excavant les sédiments contaminés ? Après analyse, Arkema estime que les effets négatifs - dégradation ponctuelle de la qualité de l’eau, dispersion de la contamination, destruction d’habitats d’espèces, coût financier élevé - l’emportent sur les gains à espérer. Un bilan partagé par les experts. Ils rappellent cependant que l’entreposage sur site des terres contaminées par les résidus radioactifs déjà présentes est une solution provisoire. Ils invitent l’industriel à réinterroger l’opportunité d’excaver les sédiments contaminés de la Risle lorsqu’une installation de stockage définitif de ces terres sera opérationnelle.
1. L’avis a été publié par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui a fusionné en janvier 2025 avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour devenir l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).
Pour en savoir plus :
AVIS IRSN N° 2024-00009 : Demande d’expertise sur l’évaluation de l’impact environnemental de la contamination des sédiments de la Risle réalisée par la société Arkema à Serquigny.
Le poids de l’histoire
La mémoire des activités polluantes d’un ancien site industriel ou de recherche est d’une importance capitale. C’est elle qui permet aux experts en charge du diagnostic puis de la gestion de la radiocontamination de localiser très précisément les sources de pollution encore présentes sur ces sites. Le radium, par exemple, une fois enfoui dans la terre à quelques centimètres de profondeur, ne présente pas de danger direct et immédiat. Les risques peuvent apparaître en cas d’excavation incontrôlée, ce qui arrive lorsque l’histoire d’un site est oubliée. En cas de soupçons, avant le diagnostic, les experts de l’ASNR (re)construisent la mémoire des sites radiocontaminés, jouent les détectives en collectant toutes sortes d’indices. Ils récupèrent tous les écrits et toutes les photos qui ont un rapport avec le site, les cahiers de laboratoires, les coupures de presse, les actes de vente pour connaître le nom des différents propriétaires et récoltent des témoignages auprès des populations.
Lorsque bâtiment ou terrains restent aux mains d’un même propriétaire ou ont servi aux mêmes activités tout au long de leur vie, l’histoire est facile à reconstituer. En revanche, tout se complique lorsque le site a changé d’affectations ou de propriétaires. Les scientifiques doivent alors déployer un arsenal technologique important et coûteux pour pister les sources de contamination sans indications précises.